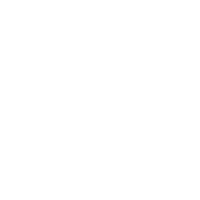Les écosystèmes aquatiques d’eau douce sont des milieux complexes et dynamiques, aux multiples ressources. Ils regroupent notamment les eaux de surface courantes (rivières, fleuves et autres cours d’eau), les zones humides (lacs, étangs, mares, mais aussi marais), ainsi que les eaux souterraines. Fait intéressant : les eaux douces couvrent moins de 1% de la planète, mais sont de véritables réservoirs de biodiversité. Elles abritent plus de 25% de tous les vertébrés, plus de 126.000 espèces animales et pas moins de 2.600 plantes aquatiques.
Les écosystèmes aquatiques d’eau douce, en plus de leur valeur intrinsèque de refuge pour la biodiversité, rendent de multiples services écosystémiques, tels que l’apport de nourriture, le contrôle des inondations, la régulation et l’épuration de l’eau, le stockage de CO2, … Ces milieux dynamiques font intégralement partie des différentes étapes du cycle de l’eau et sont le relais entre le milieu terrestre et marin. Ce sont pourtant les écosystèmes les plus dégradés au monde.


Bilan général des écosystèmes aquatiques d’eau douce
Partout dans le monde, les milieux aquatiques, qu’il s’agisse de lacs, de rivières, ou d’autres zones humides, sont confrontés à de nombreuses menaces qui mettent en péril leur fonction mais aussi leur pérennité. Cette altération de leur situation est majoritairement due à des perturbations induites par l’Homme.
L’impact de l’Homme sur l’eau douce
Les écosystèmes aquatiques d’eau douce sont en effet fortement impactés par les activités humaines, notamment suite à :
- Les aménagements et la modification des cours d’eau qui altèrent leur dynamique et entrainent une diminution de la biodiversité : barrages, endiguements, rectifications, recalibrage, qui perturbent tant les animaux que les plantes.
- La dégradation de la qualité de l’eau due notamment à la pollution par les sédiments, les engrais, les métaux lourds, les déchets plastiques ou encore des composés toxiques.
- Le réchauffement de l’eau (ou pollution thermique) lié aux rejets des eaux usées industrielles et au drainage agricole.
- La prolifération d’espèces exotiques envahissantes, comme les écrevisses américaines, la grenouille taureau ou encore la jacinthe d’eau, qui peuvent entraîner des modifications de l’habitat et nuire aux espèces indigènes.
Globalement, la dégradation de ces milieux est davantage liée à la modification de leur qualité qu’à une diminution de leur superficie. Les milieux les plus fortement impactés sont les prairies et landes humides, les forêts alluviales, les ripisylves, les tourbières et les marais.
Une menace directe pour la biodiversité aquatique
De nombreuses espèces ont besoin des écosystèmes aquatiques d’eau douce pour réaliser leur cycle biologique de manière permanente (poissons, crustacés, mollusques) ou ponctuelle (amphibiens, insectes). Par ailleurs, les milieux humides constituent des zones refuges pour de nombreux oiseaux, reptiles et mammifères ou des étapes migratoires, des lieux de reproduction ou d’hivernage pour de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques. Elles sont également le lieu d’une importante diversité de plantes (algues, roseaux, nénuphars…).
Or, confrontées à la destruction, la fragmentation et la pollution de leurs habitats naturels et de leur environnement, de nombreuses espèces végétales et animales aquatiques sont désormais menacées d’extinction.


La Directive-cadre sur l’eau (DCE)
Pour pallier l’altération des écosystèmes d’eau douce, l’Union européenne a adopté en 2000 la Directive-cadre sur l’eau ou DCE. Cette directive juridique complète vise à protéger les eaux de surface et souterraines de l’Union en définissant clairement différentes normes des états écologiques.
Les eaux de surface
L’objectif principal de la Directive est d’atteindre un bon état écologique et chimique pour l’ensemble des eaux de surface. Différents critères sont pris en compte afin de déterminer la qualité des masses d’eau de ce type :
- Biologiques, comme la diversité en espèces et l’abondance de quatre groupes indicateurs : les diatomées, les macrophytes, les macro-invertébrés et les poissons.
- Hydromorphologiques, comme le débit, la continuité écologique, la structure du lit et des berges du cours d’eau …
- Physico-chimiques, comme l’abondance des nutriments, la salinité, la température ou encore la présence de polluants.
La combinaison des différents critères permet une classification en 5 catégories pour la qualité écologique (de très bon à mauvais, en passant par bon, moyen et médiocre) et en 2 catégories pour la qualité chimique (bon et mauvais).
Les eaux souterraines
Pour les eaux souterraines, les règles divergent légèrement puisque la Directive-cadre vise à atteindre le bon état chimique et quantitatif. L’objectif est de mesurer précisément leur état chimique et de réduire la présence d’agents polluants. Les indicateurs suivants sont notamment utilisés : concentrations en nitrates, en pesticides et en métaux lourds.
Et la Wallonie dans tout ça ?
En ce qui concerne les 352 masses d’eau wallonnes, le constat est tout aussi interpellant. Le bilan général de nos eaux est en effet défavorable.


Les eaux de surface wallonnes
Une légère amélioration de l’état écologique des masses d’eau de surface (MESU) est constatée depuis quelques années. Le pourcentage de masses d’eau en bon ou très bon état a effectivement évolué de 36% entre 2007 et 2008 à 44% sur la période de 2013-2018, mais les 58% visés pour 2021 n’étaient pas encore atteints en décembre 2020. L’état chimique, en revanche, n’évolue pas positivement : sur la période comprise entre 2013 et 2018, 68% des MESU étaient en mauvaise situation.
Les principaux problèmes rencontrés se situent en majorité dans le bassin hydrographique de l’Escaut, ainsi que dans quelques sous-bassins mosans (ex. : Sambre, Meuse amont et aval, Vesdre).
Les eaux souterraines wallonnes
Concernant les masses d’eaux souterraines (MESO), 97% étaient en bon état quantitatif et 59% en bon état chimique sur la période entre 2014 et 2019. Néanmoins, le changement climatique et la sécheresse observée entre 2017 et 2019 ont induit un prélèvement plus important des masses d’eau déjà considérées comme étant en « mauvais état quantitatif » et 7 des 14 MESO montrent une tendance à la détérioration.
Il semblerait que les principales menaces soient le nitrate et les pesticides provenant de l’agriculture, qui constitue la première source de pression sur nos MESO.
L’ADN environnemental pour surveiller et protéger les écosystèmes aquatiques
L’ADN environnemental ou ADNe est une méthode scientifique qui se fonde sur la recherche des traces d’ADN laissées par les organismes vivants dans leur environnement. L’analyse d’échantillons d’eau ou de terre permet ainsi de déterminer la présence d’espèces végétales ou animales dans un milieu donné.


Dans le cadre de la protection des écosystèmes aquatiques d’eau douce, cette méthode ouvre de belles perspectives en permettant d’établir de nouveaux indicateurs génétiques de l’état écologique et biologique des masses d’eau. L’ADNe permet notamment :
– D’inventorier les espèces de poissons ou de macro-invertébrés présentent dans une rivière sans devoir les capturer.
– De déterminer les espèces de diatomées, organismes sensibles aux polluants, rapidement et avec une grande fiabilité.
– D’établir un indicateur de plantes aquatiques sans recourir à une expertise pointue en botanique.
Découvrez-en davantage sur cette méthode génétique particulièrement utile dans notre article dédié ou lisez nos autres sujets pour en savoir plus sur la biodiversité.